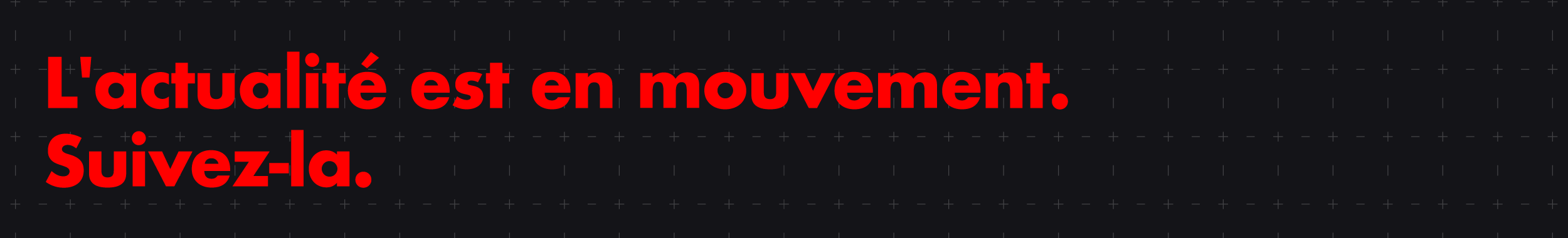La Maison-Blanche a confirmé que, dès ce samedi 1ᵉʳ février, les États-Unis appliqueront des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, et de 10 % sur ceux venant de Chine.
Le décret signé impose des taxes immédiates, sans possibilité de report. Ces sanctions sont justifiées par l’inaction de ces pays face au trafic de fentanyl et à l’immigration illégale vers les États-Unis. Le président fraîchement réélu, Donald Trump, a également indiqué son intention d’étendre ces mesures aux produits européens.
Le Canada et le Mexique, pourtant partenaires des États-Unis dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), n’ont pas réussi à convaincre Washington de revenir sur cette décision.
Le ministre canadien de la Sécurité publique, David McGuinty, a rappelé que moins de 1 % du fentanyl entrant aux États-Unis provient du Canada, soulignant les efforts déployés par le gouvernement canadien pour lutter contre cet opioïde. Pour rassurer les autorités américaines, le gouvernement Trudeau a annoncé un plan de 1,3 milliard de dollars sur six ans afin de renforcer les mesures de surveillance à la frontière canado-américaine.
La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a déclaré : « Nous défendrons toujours la dignité de nos peuples, le respect de notre souveraineté et un dialogue d’égal à égal sans subordination. »
De son côté, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis souffraient de déficits commerciaux avec le Canada et le Mexique et qu’il pourrait augmenter ces droits de douane de manière significative à l’avenir.
Les détails concernant la mise en œuvre de ces nouvelles taxes restent flous, notamment en ce qui concerne leur portée exacte et la base légale invoquée. Selon Reuters, l’administration Trump prévoit de s’appuyer sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), en arguant que la crise des surdoses de fentanyl et l’immigration illégale constituent des menaces pour la sécurité nationale. Cependant, l’utilisation de l’IEEPA dans un contexte commercial est sans précédent et pourrait faire l’objet de contestations juridiques. Une porte-parole de la Maison-Blanche a précisé qu’il n’y aurait pas de délai pour appliquer ces mesures.
Les pays concernés envisagent des représailles et pourraient intenter des actions en justice contre les États-Unis. Le Canada a d’ores et déjà annoncé qu’il réagirait de manière « ferme mais raisonnable ». Trump a également mentionné une possible exception pour le pétrole canadien, avec un droit de douane réduit à 10 % au lieu des 25 % appliqués aux autres produits en provenance du Canada. Il a aussi indiqué que de nouveaux droits de douane plus élevés sur le pétrole et le gaz naturel seraient instaurés à la mi-février, ce qui a déjà provoqué une hausse des prix du pétrole.
L’économie américaine pourrait perdre 1,2 point de croissance, selon Oxford Economics, tandis que le Mexique pourrait se retrouver en récession. Le Canada, dont les trois quarts des exportations sont destinées aux États-Unis, pourrait également souffrir fortement de ces nouvelles taxes.
Les marchés financiers ont réagi vivement à ces annonces. La monnaie canadienne et le peso mexicain se sont dépréciés, les rendements des obligations du Trésor ont augmenté et les actions ont chuté. Le Dow Jones a perdu 0,62 %, le Nasdaq est resté quasi stable avec une légère baisse de 0,08 %, et le S&P 500 a reculé de 0,22 %. Lors des précédentes hausses de droits de douane sur les produits chinois en 2018 et 2019, il fallait généralement attendre deux à trois semaines avant que les taxes ne soient perçues par les douanes, en raison des notifications nécessaires pour les importateurs.
Selon l’Agence France-Presse, le président républicain élu Donald Trump avait confirmé sa volonté d’« imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25 % sur TOUS les produits entrant aux États-Unis », dès le 20 janvier, jour de son investiture. « Cette taxe restera en vigueur jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays ! », a-t-il ajouté.
Le Mexique, dont plus de 83 % des exportations sont destinées aux États-Unis, est membre de l’accord de libre-échange d’Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada (ACEUM). De nombreuses entreprises automobiles américaines sont installées au Mexique.
Selon France Info, le fentanyl vendu sur le marché noir américain provient majoritairement du Mexique, où l’on trouve des milliers de petits laboratoires clandestins. Les deux grands cartels mexicains – Sinaloa et Jalisco – se fournissent principalement en Chine. Certains principes actifs de la puissante drogue de synthèse y sont fabriqués légalement. Le fentanyl provoque au moins 70 000 morts par overdose chaque année aux États-Unis, selon les autorités américaines.