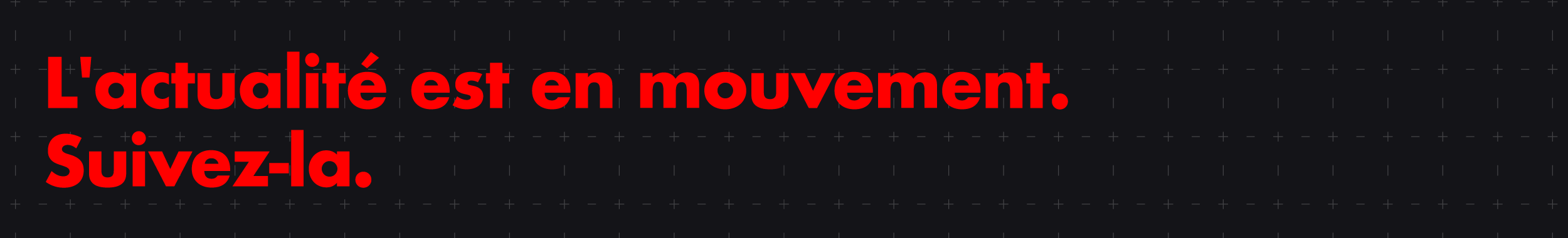L’Espagne vient de franchir un cap inquiétant dans son histoire météorologique. Selon l’Agence nationale météorologique espagnole (AEMET), le mois de juin 2025 a été le plus chaud jamais enregistré dans le pays, avec une température moyenne de 23,6 °C. Ce chiffre dépasse de 0,8 °C le précédent record, établi en 2017, et illustre une intensification des vagues de chaleur qui touchent régulièrement la péninsule ibérique.
Sur la période de référence 1991-2020, la moyenne des températures de juin a été dépassée de 3,5 °C, un écart que l’AEMET qualifie d’« exceptionnel ». Plus surprenant encore, les valeurs relevées en juin 2025 sont supérieures à celles habituellement enregistrées en juillet (23,1 °C) et en août (23 °C), mois pourtant considérés comme les plus chauds de l’année en Espagne.
L’agence météorologique souligne également que ce mois de juin présente l’écart thermique le plus marqué jamais observé par rapport aux normales saisonnières. Le sud du pays a particulièrement souffert : à Huelva, le mercure a grimpé à 46 °C, battant un record de chaleur pour un mois de juin. Le précédent, établi à Séville en 1965 avec 45,2 °C, a donc été largement dépassé.
Cette canicule précoce, qui s’inscrit dans un contexte plus large de réchauffement climatique, a touché de vastes zones du territoire espagnol, où les températures ont régulièrement dépassé les 40 °C, alors même que l’été n’en est qu’à ses débuts. Comme ses voisins du sud de l’Europe, l’Espagne doit désormais composer avec des étés de plus en plus intenses, qui menacent la santé publique, l’agriculture et la disponibilité en eau.
🔎 Contexte – Le climat méditerranéen sous pression
La Méditerranée est considérée par le GIEC comme l’un des « points chauds » du réchauffement climatique mondial. La hausse des températures y est 20 % plus rapide que la moyenne planétaire, ce qui accentue la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur. L’Espagne, exposée aux sécheresses récurrentes et aux épisodes caniculaires précoces, voit son équilibre agricole et énergétique fragilisé. Les records successifs ne relèvent plus de l’exception mais d’une tendance structurelle, qui oblige les gouvernements à repenser la gestion de l’eau, l’adaptation des infrastructures et la prévention des risques sanitaires.