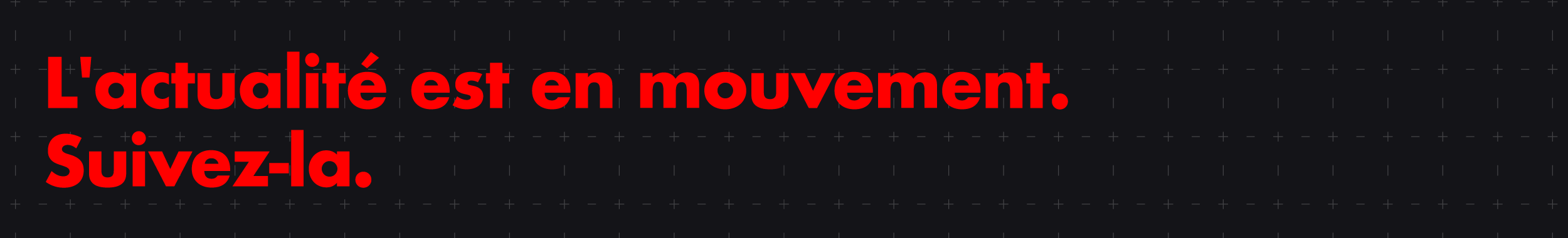Les signaux étaient inquiétants, et ce depuis plusieurs mois. Au pays où l’attente est une vertu nationale, où l’opinion publique apprend à avaler le temps plus que les résultats, la jeunesse a décidé d’y mettre un terme. Samedi 27 septembre, la génération Z, du nom du mouvement, a transformé son ébullition en cri collectif, dans toutes les villes du royaume. Considérés par les autorités comme non autorisés, ces cris légitimes de la rue ont rapidement été réprimés. Les forces de l’ordre ont interpellé par centaines les jeunes venus réclamer des réformes essentielles et nécessaires au pays.
Issu des réseaux, GENZ212 revendique une mobilisation strictement pacifique. Le mouvement, prenant de l’ampleur, s’est dès le départ désolidarisé des appels anonymes à l’affrontement, aux dégradations et aux blocages, rappelant que la mobilisation devait rester strictement pacifique. Tout se passe sur le réseau social Discord, un réseau social qui permet de communiquer facilement et instantanément sur un serveur (espace communautaire où les utilisateurs se rassemblent). En l’occurrence, GENZ212 compte plus de 148 000 membres ce jeudi. Loin de la censure, les milliers d’utilisateurs peuvent discuter sur des canaux dédiés. La communication passe également par « les canaux vocaux », où les administrateurs font participer les membres de la communauté pour partager leurs idéaux et la manière dont ils pensent qu’il faut agir. Cette inventivité populaire révèle autant l’aspiration à l’indépendance que l’obstination du pouvoir à contrôler l’espace médiatique.
Aux premières heures des mouvements, on ne voit aucun média traditionnel dans la rue venir donner la parole à la population. Censure ou autocensure ? Les seuls acteurs visibles sont des petits médias essentiellement présent sur les réseaux sociaux. Avec leurs petits moyens, ils sont là, connectés à la rue, venant donner une voix à ces citoyens, qui ont été arbitrairement arrêtés pour avoir parlé devant un micro. Aux premières heures, les télévisions publiques ont brillé par leur absence, indice d’un cadrage plus que d’une information ouverte. Il faudra attendre lundi, et la montée en tensions, pour que les articles dans les médias traditionnels commence à émerger. Trop tard, la société a transmis l’information sans intermédiaire.
Contrairement au mouvement du 20 février, les protestations actuelles ne cherchent pas plus de démocratie, elles ne cherchent pas à remettre en question notre modèle. Ce qu’elles veulent, simplement, c’est une justice sociale, de la santé, de l’éducation et du travail. Après des années de mutisme, les gens veulent des résultats concrets, et vite. En clair, peu importe qui le fait et comment : la société veut simplement le pain qui lui est dû, ce qui donne toute la légitimité à ce combat.
L’escalade des violences après seulement cinq jours de protestations risque de nuire à cette lutte. Au lendemain d’une nuit marquée par la mort de deux de nos concitoyens à Lqliâa, le Maroc se réveille avec un goût amer. La réponse politique n’est plus qu’urgente, elle est indispensable. On ne peut gouverner sans réponse à l’un des mouvements qui marquera notre société durablement. Face à cette révolte sans précédent, le Premier ministre, Aziz Akhannouch, se doit d’agir, faire face à ses responsabilités.
Responsable d’un bilan jugé désastreux par l’opposition, Akhannouch essuie un tir nourri. En juillet, Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, a dénoncé une trahison sociale et un échec économique, rappelant la promesse du RNI d’un million d’emplois créés ; c’est aujourd’hui plus de 150 000 emplois qui ont été détruits depuis 2021. À la Chambre, Abdellah Bouanou (PJD) a ajouté que « toutes les promesses pour améliorer la santé publique n’ont pas été appliquées depuis 2021 », pointant les ratés de la généralisation de l’AMO, qui laisse encore une part significative de la population en dehors du système.
« Le Maroc d’hier n’est pas le Maroc d’aujourd’hui » martelait, le chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Les décideurs devraient tenir une réflexion dans ce sens. Prendre en compte la problématique et pourquoi pas songer à s’adapter aux exigences de la population. SM le Roi le disait encore en juillet dernier, « il n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses ». Face au constat, l’exécutif persiste à réprimer plutôt qu’à soigner les maux de la société.